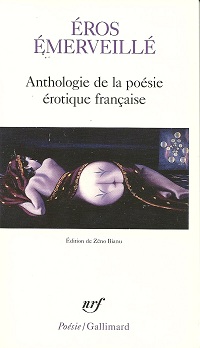Mme Claudine Bertrand, femme de parole nous fait l’honneur d’être parmi nous
Poète, éditrice, animatrice de radio, Claudine Bertrand est une femme passionnée. Son activité poétique comporte deux aspects : la création littéraire et la création de lieux de diffusion de la poésie.
Au début des années 80, des femmes poètes prennent de plus en plus et collectivement la parole dans le sillage des années 70, mais d’une manière plus intime. Claudine Bertrand fait partie de ces pionnières. Depuis cette époque, dit-elle, il y a davantage de femmes dans le monde littéraire. Bien que les lieux de parole collective se sont raréfiés, les femmes poursuivent toujours leur création et ce malgré les événements sociaux et politiques qui menacent cette parole.
En 1981, Claudine Bertrand fonde la revue Arcade réservée à l’écriture des femmes. Elle en a été l’éditrice durant plus de 25 ans. En 2006, elle crée la revue en ligne mouvances.ca pour donner la parole aux écrivains. Elle est aussi responsable du volet poétique à la revue Des Rails (desrails.free.fr). Elle participe à la mise sur pieds de l’événement La poésie dans le métro, une façon de démystifier la poésie en la rapprochant du public.
Après une carrière en enseignement de la littérature au collégial, Claudine Bertrand éprouve toujours la nécessité de parler de littérature. Elle anime une émission littéraire hebdomadaire le mercredi soir sur la chaine MF Radio Ville-Marie (91,3) de 20h à 21h.
Respectueuse du besoin de parole de chacun de nous, consciente du besoin d’expression d’une société, Claudine Bertrand nous encourage à écrire : « à chacun sa parole c’est en écrivant qu’on évolue, écrire c’est prendre le risque de trouver sa forme…»
30 ans d’activités
Claudine a publié son premier recueil en 1983, Idole errante, aux Éditions Lèvres Urbaines. Une vingtaine de recueils ont suivi, ici ou à l’étranger. Deux autres sont à paraître en France au printemps 2015. Une anthologie, Rouge assoiffée, (L’Hexagone, 2011), regroupe le parcours de l’auteure sur une période de trente ans. Louise Dupré, qui la connait bien, en a fait le choix des textes et rédigé la préface. Un livre incontournable.
Ses livres et ses activités en France et en Afrique, ont contribué à réaliser ce pont qui transporte la parole québécoise au-delà de nos frontières. D’ailleurs le prix Tristan-Tzara lui a été décerné en 2001 pour Le corps en tête. Elle est la seule québécoise, à ce jour, à avoir obtenu ce prix qui est aussi, pour elle, une reconnaissance du langage québécois, vif et original.
«Elle trempe ses mains dans l’eau de l’Éden.
Elle s’en asperge de la tête aux pieds.
Elle entre dans son regard bien décidée à aller jusqu’au bout.» (Le Corps en tête, l’Atelier des Brisants, France, 2001)
Au Québec, en 2002, le Prix Saint-Denys Garneau, lui a été décerné conjointement avec l’artiste plasticienne Chantal Legendre pour L’énigme du futur, un livre d’artiste. Ce prix signifie beaucoup pour elle d’autant plus que Saint-Denys fut un poète associé à une rupture pour ne pas dire une évolution de la poésie au Québec.
La Chute des voyelles, sorti en 2004, réagit au 11 septembre 2001, un l’événement qui fait face à l’incompréhension totale. Le style épouse cette émotion : le langage de rupture est hachuré. Ainsi, «Dire je est lourd / surtout quand il fait défaut» (p.36)
Avec Une main contre le délire, l’écriture se fait plus cinématographique. Des sortes de tableaux ou miniatures en poèmes rendent compte de l’écriture face aux situations intimes et à la vie. La forme et le titre s’imposent. Chaque livre propose une intensité à travers l’expérience de l’écriture. «Elle suivrait / n’importe qui /pour échapper à sa ligne de vie » (p.21)
Écrire c’est, pour Claudine Bertrand, se relier aux autres. Sa poésie met en image une réalité ou projette une autre vision de la réalité. Elle écrit tous les jours. Les textes s’accumulent. L’auteure choisit, élague, rassemble. Elle trouve une unité à travers tout ce déséquilibre que constitue une portion de vie en mots.
«Quand elle se voudrait à l’abri, les vertiges de l’écriture, instant après instant, l’obsède parmi phrases et silence. […] Elle retrouve invariablement son existence entre les lignes» (L’Amoureuse intérieure, 1997, p.15 et p.19)
D’un recueil à l’autre, son écriture évolue et elle me confie que plus elle vieillit plus elle s’ouvre aux autres cultures. Elle arrive à l’essentiel, quelques vers, une écriture épurée. Le mystère africain y est-il pour quelque chose?
«Avec pour malle / Ses délires / D’images/ À profusion»
(Au large du Sénégal, poésie, Éditions Rougier, collection « Plis urgents », 2013)